décembre 1990
Parlez-moi d'amour
Une salle quartier Battant à Besançon. Une silhouette trapue, une voix du terroir, un regard émerveillé et rieur...soeur Marie Christiane, 66 ans, directrice du Fourneau, aidée d'une soeur cuisinière et d'une employée, assure chaque jour la distribution et le service d'une soixantaine de repas.
Photo R. Frache.
TOPO : Vous êtes à ce poste depuis le 4 septembre 90, quel a été votre parcours, pourquoi et comment êtes vous arrivée ici ?
Soeur Marie-Christiane : «Je n'ai pas choisi. Etant religieuse je dépends d'une congrégation, de ses besoins, de son option, de son charisme...et comme il y avait un besoin ici on m'a donc sollicitée. Je n'étais pas préparée professionnellement à cela ; ma formation de base étant celle d'infirmière, sage-femme. J'ai d'ailleurs exercé près de 26 ans comme sage-femme de brousse au Tchad. Ici je suis au service des plus démunis, des gens qui sont en marge d'une société, plus ou moins rejetés d'ailleurs et qui n'ont aucun lien avec cette société si ce n'est des contacts, des démarches administratives et sociales.»
La gratuité n'est pas éducative
On parle beaucoup de précarité, de nombreuses associations et certaines personnalités ont agi afin d'y remédier. De quelle manière le Fourneau s'implique-t-il concrètement dans cette lutte ?
«Le premier objectif du Fourneau est de donner un repas chaud le midi aux personnes démunies. Ce repas leur est servi dans notre local, rue Champrond, de 11 h 30 à 13 h 30 tous les jours. Mais au-delà de cet apport matériel ces personnes retrouvent ici un peu de chaleur humaine. Cela a l'air de rien mais une petite chose comme jouer au tarot leur montre qu'on est proche d'eux, qu'ils ne sont pas des parias, qu'on les considère comme des hommes. J'essaie également de leur apprendre la solidarité entre eux à savoir que s'ils n'ont pas pu avoir un ticket de repas, ils doivent se faire aider par leurs «copains», trouver la somme nécessaire (soit 6 F) pour gagner leur repas. En effet, tous doivent faire ici l'effort de participer, la gratuité n'est pas éducative. Ma difficulté de chaque jour est donc d'obtenir cette participation très minime et de leur montrer qu'ils ne doivent pas se comporter en quémandeurs, en mendiants.»
Travaillez-vous avec d'autres organismes poursuivant les mêmes objectifs (restos du coeur, banque alimentaire...) ?
«Les tickets demandés nous sont bien entendu remboursés, essentiellement par la commune de Besançon en la personne du Centre communal d'action social. La banque alimentaire nous procure des produits en nature environ une fois par mois, certaines communautés, certains individuels le font également et puis nous avons des donateurs qui nous permettent d'acheter directement les autres produits. Les autres organismes ont un réseau plus particulier, les Restos du coeur s'occupent plus des Rmistes, des familles.»
Qui accueillez-vous ? A quelles difficultés vous heurtez-vous le plus souvent ?
«II ne faut pas rêver, ce sont des gens dans le bas de l'échelle. Ce qui me frappe c'est le nombre de jeunes qui viennent ici, des jeunes isolés, coupés de tout dialogue et pourtant en quête d'échange. La question cruciale c'est effectivement l'alcool; sur ce sujet on ne peut être ni catégorique, ni brutal. Il faut les prendre comme ils sont, jouer de beaucoup de discrétion, leur faire valoir ainsi un certain droit au respect. II ne faut pas qu'ils me ressentent comme une surveillante. Contrairement à une administration je ne suis pas à la lettre un réglement, j'ai une certaine marge de manoeuvre et c'est toujours la dimension humaine que je mets en application bien en avant de toute loi. C'est difficile de communiquer avec eux, il faut de la prudence, de la fermeté mais aussi une certaine justice, et beaucoup de bonté. S'il est vrai qu'il y a parfois des coups durs, des coups qui réussissent à m'ébranler, j'arrive pourtant à faire face. Et pour garder cet esprit d'ouverture, de tolérance, pour entendre encore ce «chez nous» prononcé par certains de nos habitués, je ne voudrais pas, dans la mesure du possible, faire intervenir la police.»
On dit qu'aujourd'hui la générosité est plus ponctuelle, qu'on ne s'investit pas ou plus dans des actions de longue haleine...
«Je crois effectivement qu'on peut arriver à sensibiliser les gens dans un moment donné pour une cause donnée, les Téléthons en sont la preuve. Je pense qu'il y a de la générosité mais maintenant on n'ose plus dire, on a peur. Est-ce qu'on n'a pas abusé justement de cette discrétion ? En Afrique la communication fait partie de la vie. Elle n'est pas le reflet d'une surconsommation mais moyen de dialogue entre les hommes. Cela fait deux ans que je suis rentrée du Tchad mais je suis encore choquée par cette pression exercée par les affiches, par toutes sortes de choses. Tout ce que je donne de moi au service de ces gens c'est un acte gratuit, c'est inscrit dans ma vocation, c'est difficile d'expliquer cela autrement. Au départ, j'ai eu peur de «travailler» ici; tout comme les autres j'avais un regard «négatif» sur ces personnes. Ce n'est pas pour faire marcher une machine que je suis là mais pour donner un témoignage de compréhension, de l'amour de Dieu pour tout homme. Je suis encore, à mon âge, en période de découverte.»
Quel contraste entre ce que vous avez vécu en Afrique et le monde d'ici ?
«II y a certes des ressemblances, mais au delà d'une certaine psychologie commune, c'est un autre monde que je découvre; un monde de pauvres dans une civilisation organisée. En Afrique les démunis souffrent de la faim, de la maladie mais jamais d'isolement moral. Ils ont le sens du clan, de la famille. Il n'y a pas d'isolé dans les pays du tiers-monde.»
Recueilli par Eric Poinsot et Claire Boisson
Soeur Marie-Christiane : «Je n'ai pas choisi. Etant religieuse je dépends d'une congrégation, de ses besoins, de son option, de son charisme...et comme il y avait un besoin ici on m'a donc sollicitée. Je n'étais pas préparée professionnellement à cela ; ma formation de base étant celle d'infirmière, sage-femme. J'ai d'ailleurs exercé près de 26 ans comme sage-femme de brousse au Tchad. Ici je suis au service des plus démunis, des gens qui sont en marge d'une société, plus ou moins rejetés d'ailleurs et qui n'ont aucun lien avec cette société si ce n'est des contacts, des démarches administratives et sociales.»
La gratuité n'est pas éducative
On parle beaucoup de précarité, de nombreuses associations et certaines personnalités ont agi afin d'y remédier. De quelle manière le Fourneau s'implique-t-il concrètement dans cette lutte ?
«Le premier objectif du Fourneau est de donner un repas chaud le midi aux personnes démunies. Ce repas leur est servi dans notre local, rue Champrond, de 11 h 30 à 13 h 30 tous les jours. Mais au-delà de cet apport matériel ces personnes retrouvent ici un peu de chaleur humaine. Cela a l'air de rien mais une petite chose comme jouer au tarot leur montre qu'on est proche d'eux, qu'ils ne sont pas des parias, qu'on les considère comme des hommes. J'essaie également de leur apprendre la solidarité entre eux à savoir que s'ils n'ont pas pu avoir un ticket de repas, ils doivent se faire aider par leurs «copains», trouver la somme nécessaire (soit 6 F) pour gagner leur repas. En effet, tous doivent faire ici l'effort de participer, la gratuité n'est pas éducative. Ma difficulté de chaque jour est donc d'obtenir cette participation très minime et de leur montrer qu'ils ne doivent pas se comporter en quémandeurs, en mendiants.»
Travaillez-vous avec d'autres organismes poursuivant les mêmes objectifs (restos du coeur, banque alimentaire...) ?
«Les tickets demandés nous sont bien entendu remboursés, essentiellement par la commune de Besançon en la personne du Centre communal d'action social. La banque alimentaire nous procure des produits en nature environ une fois par mois, certaines communautés, certains individuels le font également et puis nous avons des donateurs qui nous permettent d'acheter directement les autres produits. Les autres organismes ont un réseau plus particulier, les Restos du coeur s'occupent plus des Rmistes, des familles.»
Qui accueillez-vous ? A quelles difficultés vous heurtez-vous le plus souvent ?
«II ne faut pas rêver, ce sont des gens dans le bas de l'échelle. Ce qui me frappe c'est le nombre de jeunes qui viennent ici, des jeunes isolés, coupés de tout dialogue et pourtant en quête d'échange. La question cruciale c'est effectivement l'alcool; sur ce sujet on ne peut être ni catégorique, ni brutal. Il faut les prendre comme ils sont, jouer de beaucoup de discrétion, leur faire valoir ainsi un certain droit au respect. II ne faut pas qu'ils me ressentent comme une surveillante. Contrairement à une administration je ne suis pas à la lettre un réglement, j'ai une certaine marge de manoeuvre et c'est toujours la dimension humaine que je mets en application bien en avant de toute loi. C'est difficile de communiquer avec eux, il faut de la prudence, de la fermeté mais aussi une certaine justice, et beaucoup de bonté. S'il est vrai qu'il y a parfois des coups durs, des coups qui réussissent à m'ébranler, j'arrive pourtant à faire face. Et pour garder cet esprit d'ouverture, de tolérance, pour entendre encore ce «chez nous» prononcé par certains de nos habitués, je ne voudrais pas, dans la mesure du possible, faire intervenir la police.»
On dit qu'aujourd'hui la générosité est plus ponctuelle, qu'on ne s'investit pas ou plus dans des actions de longue haleine...
«Je crois effectivement qu'on peut arriver à sensibiliser les gens dans un moment donné pour une cause donnée, les Téléthons en sont la preuve. Je pense qu'il y a de la générosité mais maintenant on n'ose plus dire, on a peur. Est-ce qu'on n'a pas abusé justement de cette discrétion ? En Afrique la communication fait partie de la vie. Elle n'est pas le reflet d'une surconsommation mais moyen de dialogue entre les hommes. Cela fait deux ans que je suis rentrée du Tchad mais je suis encore choquée par cette pression exercée par les affiches, par toutes sortes de choses. Tout ce que je donne de moi au service de ces gens c'est un acte gratuit, c'est inscrit dans ma vocation, c'est difficile d'expliquer cela autrement. Au départ, j'ai eu peur de «travailler» ici; tout comme les autres j'avais un regard «négatif» sur ces personnes. Ce n'est pas pour faire marcher une machine que je suis là mais pour donner un témoignage de compréhension, de l'amour de Dieu pour tout homme. Je suis encore, à mon âge, en période de découverte.»
Quel contraste entre ce que vous avez vécu en Afrique et le monde d'ici ?
«II y a certes des ressemblances, mais au delà d'une certaine psychologie commune, c'est un autre monde que je découvre; un monde de pauvres dans une civilisation organisée. En Afrique les démunis souffrent de la faim, de la maladie mais jamais d'isolement moral. Ils ont le sens du clan, de la famille. Il n'y a pas d'isolé dans les pays du tiers-monde.»
Recueilli par Eric Poinsot et Claire Boisson
articles
- • Réaction
- • Le Cics célèbre ses 50 ans avec Camille Aumont-Carnel
- • Cinq conseils pour bien gérer son argent
- • A l'ouest
- • Les formations aux premiers secours, apprendre à réagir
- • Banque populaire Bourgogne Franche-Comté : révélons vos talents !
- • Services civiques, missions d'intérêt général
- • Volontariat : multiples voies d'engagement
- • Voies d'engagement
- • Astuces
express
Droits des femmes en régression
mars 2025
En 2024, l'Onu signale une régression des droits des femmes dans un quart des pays ! Hausse des discriminations liées au sexe, diminution des ressources financières., mysoginie en phase de généralisation selon António Guterres. Un constat déplorable renforcée, selon l'Onu, par " le numérique et l’intelligence artificielle qui propagent des stéréotypes néfastes, tandis que la fracture numérique entre les sexes restreint les perspectives offertes aux femmes ". Lire ici.
Réseaux
février 2025
Désormais, vous pouvez nous suivre sur Blue sky.
Volontariat et bénévolat
février 2025
La différence principale entre volontariat et bénévolat tient au contrat stipulant l’engagement dans le premier cas alors que le bénévolat est un engagement libre, sans contrat. En conséquence, le volontaire a un statut et une couverture sociale complète. Par ailleurs, le volontariat est souvent assorti d’indemnités.
Le bénévolat associatif
janvier 2025
Le bénévolat associatif c’est s’engager librement et agir dans l’intérêt d’une association ou d’une fondation, de manière ponctuelle ou régulière. Toute personne sans conditions d’âge ni de diplôme peut s’engager bénévolement dans l’association de son choix.
Concours Amnesty
novembre 2024
Amnesty international Besançon organise 2 concours pour les droits humains :
- un concours d'illustrations ouvert aux collégiens, lycéens et étudiants : il s'agit de créer une couverture de BD à partir d'une nouvelle primée l'an dernier (accessibles sur plumesrebelles.fr) avant le 24 janvier.
- un concours de nouevlles ouverts aux collégiens, lycéens, étudiants et apprentis, avant le 17 janvier. Thèmes d'écriture : les discrimnations : sources de violence ? / droits acquis : la vigilance s'impose pour les préserver / la nature a-t-elle des droits ? / l'IA : un risque pour les libertés individuelles et collectives ?
Infos sur plumesrebelles.fr Voir tout


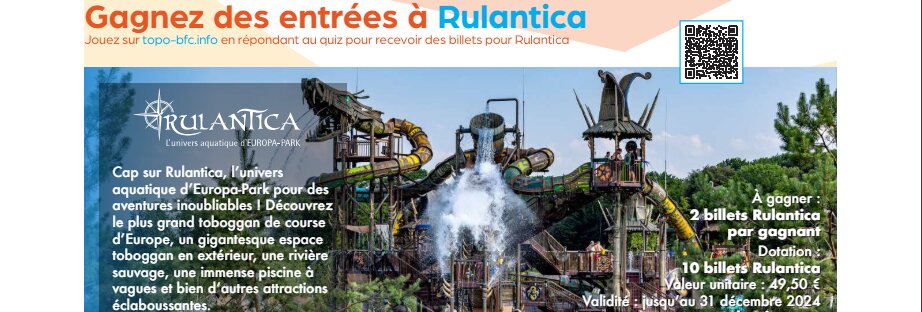
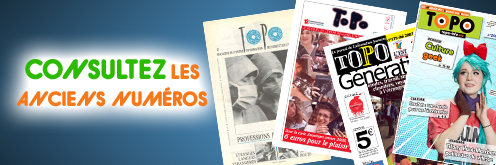

Commentaires
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.