Accueil > Articles > TOPO n°85 > Quotidien > Société & citoyenneté > Peut-on encore faire l'économie du bio ?
juin 1998
Peut-on encore faire l'économie du bio ?
L'agriculture «bio», comme on l'appelle, est encore minoritaire. Mais offre et demande croissent.
Jardin de grand-maman pour les uns, idéal peu réaliste de quelques rêveurs pour d'autres, quand elle n'est pas décrite comme l'activité de marginaux farouchement à l'écart : le bio a du mal à se défaire d'images tenaces à peine dépassées. Pourtant, il revient au devant de la scène, en contrecoup de quelques problèmes plus ou moins récents mais aussi irrésolus que grandissants. Il y avait déjà les interogations sur la surproduction, le développement durable ou le respect de l'environnement, il s'y ajoute désormais les inquiétudes face à l'alimentation, vache folle et maïs transgénique dans les assiettes. Un ensemble de difficultés auxquelles, le bio peut, selon ses défenseurs, en partie remédier. Jacques Lançon est l'un d'eux : technicien en agriculture biologique pendant 15 ans, il a ouvert en 83 la SARL «Pour le bio», qui vend des produits agricoles à Montmorot, près de Lons-le-Saunier. « L'agrobiologiste moderne cherche aussi à être rentable insiste-t-il. Mais il le fait en obéissant aux lois de la fertilité des sols et à l'impératif qualitatif pour le consommateur, en gardant le respect de l'écosystème. C'est d'abord une question de volonté et de conviction... Mais il est difficile de comprendre qu'il faille attendre que les faits soient avérés pour dire halte. On se doutait bien que les pesticides, par exemple, auraient des effets néfastes ! »
Remise en cause de l'agriculture intensive et productiviste, le bio possède aussi ses inconvénients, dont celui d'être plus exposé aux aléas de la nature. Guy Le Hénaff, ingénieur du service régional de protection des végétaux, ne tranche pas : « Il y a la place pour les deux types d'agriculture. Certains agriculteurs travaillent très bien en bio, connaissent leur métier mais on n'est jamais à l'abri d'impondérables, du climat, des maladies. Mettez un mois de juin pluvieux sur un champ de pommes de terre et le mildiou va arriver. Faire du tout bio, c'est s'exposer certaines années à l'absence de récolte. Donc, à l'échelle nationale c'est problématique. Et il y a des idées préconçues sur le laissez-faire naturel. Avec le phytosanitaire par exemple, on s'affranchit des aléas de la nature ». Mais il l'admet, « on sent que la société va demander de plus en plus des comptes par rapport aux productions. Il y aura une nécessité de transparence, on essaye d'y sensibiliser les agriculteurs ».
La production intensive répondait à une demande
Productivistes, pollueurs, répandeurs de nitrates et désherbants, désormais empoisonneurs, ces derniers ne sont, de l'avis général, pas seuls responsables. Que l'on sache, tous les produits qu'ils utilisent sont légaux ! Pascal Bérion, de l'Université de Franche-Comté, résume un avis partagé : « Les lois d'orientation agricole de 62, qui ont permis la modernisation de l'agriculture, ont fait en sorte de rendre l'agriculture française très productive, très moderne, l'une des plus performantes au monde. Le message qu'on lui a donné était de produire beaucoup et pas cher, il ne faut pas l'oublier. Si aujourd'hui l'on regrette un certain nombre d'erreurs, d'atteintes au milieu naturel, c'est aussi l'une des conséquences de notree politique agricole ».
Les agriculteurs insistent sur cette réalité, à l'image de Sylvain Marinier, président du CDJA dans le Doubs : « C'était un choix de société et une mission qu'on nous a donnée. Et effectivement, on a été débordé par la technologie, mais tout le monde, les scientifiques et les politiques, aussi. Aujourd'hui que l'on a atteint l'autosuffisance, il est clair qu'il faut mettre un terme à ça, arrêter de mettre des porcs en Bretagne, de répandre toujours plus d'azote, de faire du transgénique de manière non raisonnée. En tous cas, dans la région, nous sommes clairs là-dessus. En Franche-Comté, on peut mettre sans problème sur la table nos chiffres, nos pratiques en terme d'utilisation d'engrais, de mise aux normes des bâtiments d'élevage ou de gestion de l'eau...»
Le 12 décembre 1997, un plan quinquennal de soutien à l'agriculture bio a été présenté par le ministre de l'Agriculture et de la Pêche. Cette année, le projet de loi d'orientation agricole prend le contrepied de la logique productiviste. En parlant du bio, il est évoqué un pacte économique et écologique à la base d'une nouvelle révolution agricole. Sans aller jusque là, on peut simplement parler d'une mutation, qui permettrait à l'agriculture de sortir des années... 60. « L'agriculture biologique n'est reconnue officiellement que depuis 7 - 8 ans, avec une prise de conscience des dangers de l'alimentation et de l'agriculture industrielles indique Jacques Lançon. Mais si des pays comme l'Autriche, la Hollande ou l'Allemagne ont sauté à pieds joints dès 75 dans les propositions européennes de financement d'une agriculture plus naturelle, la France n'a rien fait pour encourager le mouvement bio. Dans les années 70, c'était un pays pilote à la suite d'initiatives privées, à l'heure actuelle, elle se retrouve en queue de peloton.» Effectivement, en 1985, la France se présentait encore comme le principal producteur biologique européen, fournissant près de 50 % des denrées de ce type. En 1997, ce chiffre est tombé à 7 %, la France au 14e rang. Elle parvient si peu à répondre à la demande intérieure, grandissante, que les importations de produits bio ont été multipliées par 20 entre 1993 et 1996 !
« Plus on a avancé dans la transfor mation du monde rural et plus il est difficile de revenir à des systèmes non coincés dans cette logique productiviste se désole Jacques Lançon Aujourd'hui, les jeunes qui s'installent sont formés à cette logique et n'ont plus le savoir-faire lié au cycle naturel. On en fait des chefs d'entreprise sans notion sur les problèmes de gestion des ressources situées à quelques mètres sous la terre cultivée ».
Stéphane Paris
Remise en cause de l'agriculture intensive et productiviste, le bio possède aussi ses inconvénients, dont celui d'être plus exposé aux aléas de la nature. Guy Le Hénaff, ingénieur du service régional de protection des végétaux, ne tranche pas : « Il y a la place pour les deux types d'agriculture. Certains agriculteurs travaillent très bien en bio, connaissent leur métier mais on n'est jamais à l'abri d'impondérables, du climat, des maladies. Mettez un mois de juin pluvieux sur un champ de pommes de terre et le mildiou va arriver. Faire du tout bio, c'est s'exposer certaines années à l'absence de récolte. Donc, à l'échelle nationale c'est problématique. Et il y a des idées préconçues sur le laissez-faire naturel. Avec le phytosanitaire par exemple, on s'affranchit des aléas de la nature ». Mais il l'admet, « on sent que la société va demander de plus en plus des comptes par rapport aux productions. Il y aura une nécessité de transparence, on essaye d'y sensibiliser les agriculteurs ».
La production intensive répondait à une demande
Productivistes, pollueurs, répandeurs de nitrates et désherbants, désormais empoisonneurs, ces derniers ne sont, de l'avis général, pas seuls responsables. Que l'on sache, tous les produits qu'ils utilisent sont légaux ! Pascal Bérion, de l'Université de Franche-Comté, résume un avis partagé : « Les lois d'orientation agricole de 62, qui ont permis la modernisation de l'agriculture, ont fait en sorte de rendre l'agriculture française très productive, très moderne, l'une des plus performantes au monde. Le message qu'on lui a donné était de produire beaucoup et pas cher, il ne faut pas l'oublier. Si aujourd'hui l'on regrette un certain nombre d'erreurs, d'atteintes au milieu naturel, c'est aussi l'une des conséquences de notree politique agricole ».
Les agriculteurs insistent sur cette réalité, à l'image de Sylvain Marinier, président du CDJA dans le Doubs : « C'était un choix de société et une mission qu'on nous a donnée. Et effectivement, on a été débordé par la technologie, mais tout le monde, les scientifiques et les politiques, aussi. Aujourd'hui que l'on a atteint l'autosuffisance, il est clair qu'il faut mettre un terme à ça, arrêter de mettre des porcs en Bretagne, de répandre toujours plus d'azote, de faire du transgénique de manière non raisonnée. En tous cas, dans la région, nous sommes clairs là-dessus. En Franche-Comté, on peut mettre sans problème sur la table nos chiffres, nos pratiques en terme d'utilisation d'engrais, de mise aux normes des bâtiments d'élevage ou de gestion de l'eau...»
Le 12 décembre 1997, un plan quinquennal de soutien à l'agriculture bio a été présenté par le ministre de l'Agriculture et de la Pêche. Cette année, le projet de loi d'orientation agricole prend le contrepied de la logique productiviste. En parlant du bio, il est évoqué un pacte économique et écologique à la base d'une nouvelle révolution agricole. Sans aller jusque là, on peut simplement parler d'une mutation, qui permettrait à l'agriculture de sortir des années... 60. « L'agriculture biologique n'est reconnue officiellement que depuis 7 - 8 ans, avec une prise de conscience des dangers de l'alimentation et de l'agriculture industrielles indique Jacques Lançon. Mais si des pays comme l'Autriche, la Hollande ou l'Allemagne ont sauté à pieds joints dès 75 dans les propositions européennes de financement d'une agriculture plus naturelle, la France n'a rien fait pour encourager le mouvement bio. Dans les années 70, c'était un pays pilote à la suite d'initiatives privées, à l'heure actuelle, elle se retrouve en queue de peloton.» Effectivement, en 1985, la France se présentait encore comme le principal producteur biologique européen, fournissant près de 50 % des denrées de ce type. En 1997, ce chiffre est tombé à 7 %, la France au 14e rang. Elle parvient si peu à répondre à la demande intérieure, grandissante, que les importations de produits bio ont été multipliées par 20 entre 1993 et 1996 !
« Plus on a avancé dans la transfor mation du monde rural et plus il est difficile de revenir à des systèmes non coincés dans cette logique productiviste se désole Jacques Lançon Aujourd'hui, les jeunes qui s'installent sont formés à cette logique et n'ont plus le savoir-faire lié au cycle naturel. On en fait des chefs d'entreprise sans notion sur les problèmes de gestion des ressources situées à quelques mètres sous la terre cultivée ».
Stéphane Paris
articles
- • Réaction
- • Le Cics célèbre ses 50 ans avec Camille Aumont-Carnel
- • Cinq conseils pour bien gérer son argent
- • A l'ouest
- • Les formations aux premiers secours, apprendre à réagir
- • Banque populaire Bourgogne Franche-Comté : révélons vos talents !
- • Services civiques, missions d'intérêt général
- • Volontariat : multiples voies d'engagement
- • Voies d'engagement
- • Astuces
express
Droits des femmes en régression
mars 2025
En 2024, l'Onu signale une régression des droits des femmes dans un quart des pays ! Hausse des discriminations liées au sexe, diminution des ressources financières., mysoginie en phase de généralisation selon António Guterres. Un constat déplorable renforcée, selon l'Onu, par " le numérique et l’intelligence artificielle qui propagent des stéréotypes néfastes, tandis que la fracture numérique entre les sexes restreint les perspectives offertes aux femmes ". Lire ici.
Réseaux
février 2025
Désormais, vous pouvez nous suivre sur Blue sky.
Volontariat et bénévolat
février 2025
La différence principale entre volontariat et bénévolat tient au contrat stipulant l’engagement dans le premier cas alors que le bénévolat est un engagement libre, sans contrat. En conséquence, le volontaire a un statut et une couverture sociale complète. Par ailleurs, le volontariat est souvent assorti d’indemnités.
Le bénévolat associatif
janvier 2025
Le bénévolat associatif c’est s’engager librement et agir dans l’intérêt d’une association ou d’une fondation, de manière ponctuelle ou régulière. Toute personne sans conditions d’âge ni de diplôme peut s’engager bénévolement dans l’association de son choix.
Concours Amnesty
novembre 2024
Amnesty international Besançon organise 2 concours pour les droits humains :
- un concours d'illustrations ouvert aux collégiens, lycéens et étudiants : il s'agit de créer une couverture de BD à partir d'une nouvelle primée l'an dernier (accessibles sur plumesrebelles.fr) avant le 24 janvier.
- un concours de nouevlles ouverts aux collégiens, lycéens, étudiants et apprentis, avant le 17 janvier. Thèmes d'écriture : les discrimnations : sources de violence ? / droits acquis : la vigilance s'impose pour les préserver / la nature a-t-elle des droits ? / l'IA : un risque pour les libertés individuelles et collectives ?
Infos sur plumesrebelles.fr Voir tout

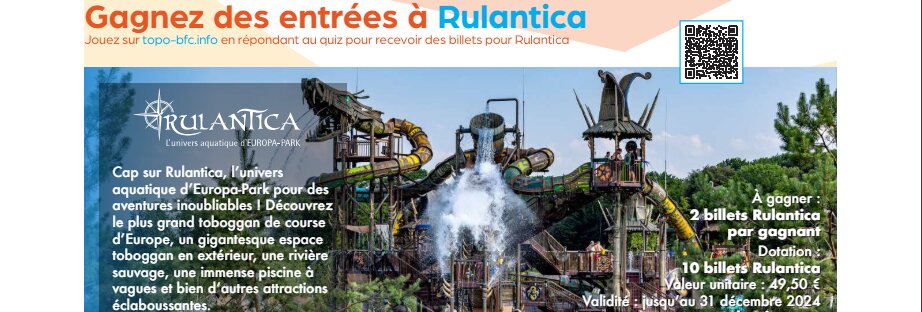
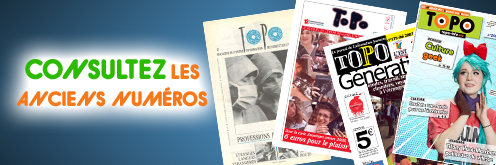


Commentaires
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.